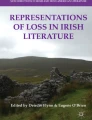Abstract
The essay examines the relation between the explicit aesthetic ideology of Proust’s Recherche and the structure of the “involuntary memory” that is supposed to serve as that ideology’s empirical basis. I challenge the apparent solipsism and idealism of the narrator’s aesthetics by focusing on the one experience of involuntary memory that he omits from his final reflections, in Time Regained, on the relation between memory and art: this is the involuntary memory, in the earlier volume Sodom and Gomorrah, of his dead grandmother, a memory that he describes there as an experience of true otherness. Through a close reading of this passage, I argue that Proust’s interest in involuntary memory implies a concept of literary art as above all ethical in nature, in so far as it is the only means by which individuals can emerge from the solitude to which they are otherwise existentially condemned. In both the Sodom and Gomorrah passage and a later passage from Time Regained this emergence is cast in terms of a rhetoric of multiplicity that emphasizes both the disturbing and the productive dimensions connecting literature with life.
Similar content being viewed by others
Notes
“L’artiste qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie avec an ami sait qu’il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n’existe pas (les amis n’étant des amis que dans cette douce folie que nous avons au cours de la vie, à laquelle nous nous prêtons, mais que du fond de notre intelligence nous savons l’erreur d’un fou qui croirait que les meubles vivent et causerait avec eux),” Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (Paris: Éditions Gallimard, 1989) v. 4. 454. Unless otherwise noted, all translations are my own.
Gérard Genette, Figures III (Paris: Éditions du Seuil, 1972) 264–265.
“Aussitôt l’essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi... s’éveille, s’anime... Une minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l’homme affranchi de l’ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu’il soit confiant dans sa joie, même si le simple gout d’une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie, on comprend que le mot de ‘mort’ n’ait pas de sens pour lui; situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l’avenir?” (4.451).
“Cet être-là n’était jamais venu à moi, ne s’était jamais manifesté, qu’en dehors de l’action, de la jouissance immediate, chaque fois que le miracle d’une analogie m’avait fait échapper au présent” (4.450, emphasis added).
“Cette contemplation de l’essence des choses, j’étais maintenant decidé à m’attacher à elle, à la fixer, mais comment? Par quel moyen?” (4.454).
“Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu’était-ce autre chose que faire une œuvre d’art?” (4.457).
History and Ideology in Proust: A la recherche du temps perdu and the Third French Republic (Cambridge: Cambridge University Press 1995) 176.
Proust Between Two Centuries, trans. Richard Goodkin (New York: Columbia University Press, 1992) 123–124. First published by Seuil (Paris 1989).
Le temps sensible: Proust et l’expérience littéraire (Paris: Gallimard 1994).
“≪Oh! De rien. Cela ne m’a fait perdre qu’un temps infini≫ (pour infime)” (1954) v. 2. 755.
The second sentence of the paragraph reads: “Dès la première nuit, comme je souffrais d’une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence pour me déchausser” (755).
“À peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s’enfla, remplie d’une presence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L’être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l’âme, c’était celui qui, plusiers années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identiques, dans un moment où je n’avais plus rien de moi, était entré, et qui m’avait rendu à moi-même, car il était moi et plus que moi (le contenant qui est plus que le contenu et me l’apportait)” 2.755–756.
“Je venais d’apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand’mère, telle qu’elle avait été ce premier soir d’arrivée; le visage de ma grand’mère, non pas de celle que je m’étais étonné et reproché de si peu regretter et qui n’avait d’elle que le nom, mais de ma grand’mère veritable dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité n’existe pas pour nous tant qu’elle n’a pas été récréée par notre pensée (sans cela les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques); et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n’était qu’à l’instant – plus d’une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments – que je venais d’apprendre qu’elle était morte” (756).
“Je me rappelais comme, une heure avant le moment où ma grand’mère s’était penchée ainsi dans sa robe de chambre vers mes bottines, errant dans la rue étouffante de chaleur, devant le pâtissier, j’avais crue que je ne pourrais jamais, dans le besoin que j’avais de l’embrasser, attendre l’heure qu’il me fallait encore passer sans elle. Et maintenant que ce même besoin renaissait, je savais que je pouvais attendre des heures après des heures, qu’elle ne serait plus jamais auprès de moi, je ne faisais que de le découvrir parce que je venais, en la sentant, pour la première fois, vivante, veritable, gonflant mon cœur à la briser, en la retrouvant enfin, d’apprendre que je l’avais perdue pour toujours. Perdue pour toujours; je ne pouvais comprendre, et je m’exerçais à subir la souffrance de cette contradiction : d’une part, une existence, une tendresse, survivantes en moi telles que je les avais connue . . . et, d’autre part . . . la certitude . . . d’un néant qui avait effacé mon image de cette tendresse, qui avait détruit cette existence, aboli rétrospectivement notre mutuelle prédestination, fait de ma grand’mère, au moment où je la retrouvais comme dans un miroir, une simple étrangère qu’un hasard a fait passer quelques années auprès de moi, comme cela aurait pu être auprès de tout autre, mais pour qui, avant et après, je n’étais rien, je ne serais rien” (757–758).
“La vrai vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par consequent pleinement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas ≪développés≫. Notre vie; et aussi la vie des autres; car le style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique mais de vision. Il est la revelation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la difference qualitative qu’il y a dans la façon don’t nous apparaît le monde, difference qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternell de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le meme que le nôtre et don’t les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l‘infini...” (4.474). The variants list the following, erased note from the margins of the manuscript: “Cette vie que, en un sens la foule a aussi bien que l’artiste mais qui habite... ” (4.1267). The editors also cite a note from the 1908 preliminary sketch, which directly connects this passage to the madeleine episode (1267–68, n.2).
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Moll, P. Community, Communication and Multiplicity in Proust. Philosophia 36, 55–65 (2008). https://doi.org/10.1007/s11406-007-9097-1
Received:
Accepted:
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s11406-007-9097-1